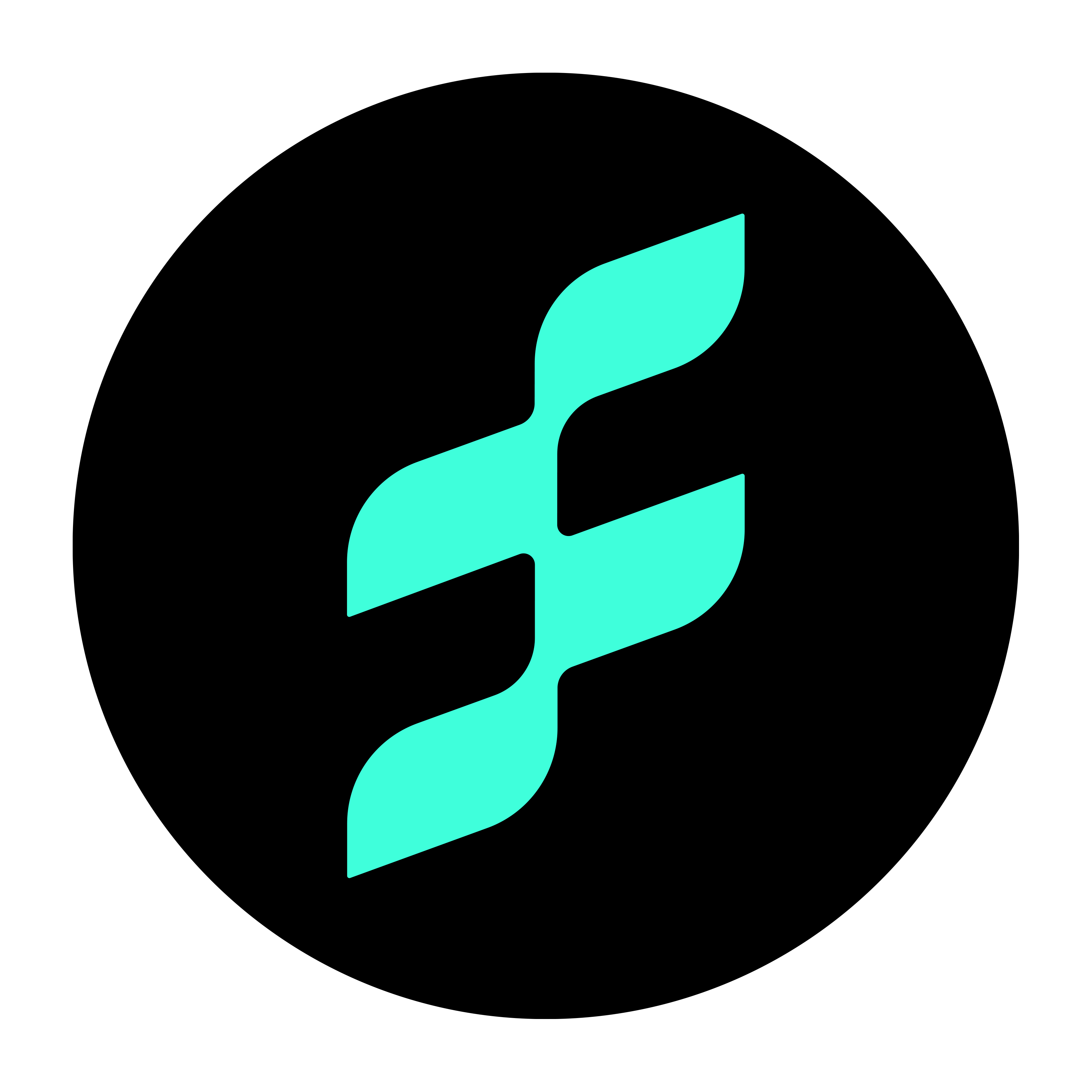Le droit sur l’héritage n’a cessé d’évoluer et de refléter l’évolution de l’histoire de la famille. Les droits de l’épouse, en particulier, donnent également une idée du statut de la femme. De l’Égypte ancienne à la France contemporaine en passant par la Grèce, Rome et l’histoire de notre pays, voyons à quoi Madame a droit au décès de son époux…
Article par Paule Valois, paru dans le magazine Historia
Dans l’Égypte ancienne, la femme est juridiquement l’égale de l’homme au sein de la famille qu’ils ont constituée par leur union. Elle peut hériter de son époux, au même titre que ses enfants. La femme agit et reçoit son héritage sans aucune tutelle d’un tiers.
Alors qu’à la même époque en Mésopotamie, les droits successoraux de la femme étaient très limités. À Athènes, le conjoint survivant, mari ou femme, n’a aucun droit de succession non plus. Le testament est inconnu à l’origine dans les législations grecques. Un citoyen tient sa fortune de sa lignée et doit la conserver et la transmettre telle quelle à sa descendance ou, à défaut, à ses collatéraux.
C’est Solon (640-558 av. J.-C.) qui institue le testament à Athènes en autorisant les Athéniens sans enfant à transmettre leurs biens à qui bon leur semble. En ce qui concerne leur épouse, ils peuvent la « léguer » à un parent chargé de l’épouser avec une dot déterminée.
C’est ce que fait le père du grand orateur et homme politique Démosthène (384-322 av. J.C.) qui transmet sa femme à Aphobus, son neveu. Ce dernier dissipe la dot sans épouser la mère et se retrouve donc sur le banc des accusés lors d’un procès dans lequel le jeune Démosthène, il n’a que dix-sept ans, plaide lui-même avec grand talent.
Rome : une loi transgressée au bénéfice des femmes
À Rome, les femmes peuvent être appelées à être instituées héritières car le père de famille a le droit de disposer de ses biens par testament. De manière générale, si elle est mariée cum manu, c’est-à-dire sous le régime juridique de la manus, elle est considérée juridiquement comme la fille de son mari et aura donc des droits sur sa succession mais en perdant l’héritage de son propre père.
Sans la fameuse manus, la femme mariée reste soumise à la puissance de son père et garde sa vocation à lui succéder.
De Caton l’ancien…
Cependant, Caton l’ancien (324-149 av. J.-C.) modifie la situation. Effrayé par l’émancipation des femmes et persuadé que leur influence est destructrice pour l’ordre civil romain, il est à l’origine de la Loi Voconia, de 169 av. J.-C. Cette loi interdit à tout Romain inscrit sur la liste du cens (dénombrement notamment fiscal des citoyens) pour 100 000 as et plus (la première classe, celle qui a l’autorité politique prépondérante) d’instituer une femme pour héritière dans son testament.
Quant aux autres, ils ne peuvent pas transmettre plus de la moitié de leurs biens par legs. Nombreux sont les Romains qui détournent cette loi en ne se déclarant pas sur la liste du cens ou en taisant l’augmentation de leur cens.
Autre façon qui se répand de contourner la loi : l’usage des fideicommis, sorte de messagers chargés d’exécuter les dernières volontés du testateur. C’est le cas de Sextus Peduceus auquel C. Plotius transmet son héritage, apparemment sans condition, mais en vérité avec une mission : il se présente chez la veuve, lui révèle les souhaits de son époux et lui remet l’héritage en mains propres.

Fulvia et Marc Antoine, ou La vengeance de Fulvia
… à Auguste
C’est l’empereur Auguste qui redonne des droits aux épouses. Il protège les fideicommis afin de favoriser la transmission des biens aux femmes, puis promulgue les lois décimaires (vers l’an 8) qui rendent inapplicable la loi Voconia.
En effet, tout époux peut désormais, par testament, instituer son conjoint héritier d’un dixième de la totalité de ses biens et de l’usufruit d’un tiers. Le but est de favoriser le mariage dans le contexte de célibat, de guerre civile et de dépopulation connu à la fin de la République romaine.
De plus, sous Auguste, le jus liberorum exempte les femmes de toute tutelle, et leur donne la capacité de recevoir des dons et legs de leur mari. Ce privilège était déjà en vigueur sous Jules César mais réservé aux mères de trois enfants. Il est destiné à durer jusqu’à la fin de l’Empire.
L’usage des fideicommis perdure malgré une loi plus ouverte. D’ailleurs, Titius, qui laisse à son épouse un dixième et l’usufruit du tiers de ses biens et institue pour héritier le père de son épouse, est soupçonné d’avoir, en réalité, nommé un fideicommis pour avantager encore plus cette dernière. En 410, les lois décimaires sont abrogées par l’empereur Théodose.
Le temps des douairières
Dès l’époque franque, le droit germanique influence en particulier les « pays de coutume », au nord de la Loire, où s’installe la notion de communauté de biens entre les époux. Le conjoint survivant recueille la moitié de la communauté. La distinction entre les propres (biens hérités des générations antérieures, propres à chacun des conjoints) et les acquêts (biens acquis par le couple durant le mariage) vient du droit germanique.
La notion d’acquêts ainsi que les droits de l’épouse sont mentionnés dans le Capitulaire de 821 qui précise que l’épouse a droit au tiers voire à la moitié (depuis la fin du VIe siècle) de tout ce que le couple a acquis durant la période du mariage. En 638, la veuve du roi Dagobert, Nantechilde, recueille un tiers des acquêts.
Du Nord…
Au nord, les institutions d’origine franque sont très sensibles à la protection de la veuve. C’est l’origine du douaire qui est le droit conféré à la veuve de profiter de façon viagère (jusqu’à son décès) d’une partie des immeubles propres du mari défunt. Des biens d’ailleurs parfois affectés dès le mariage.
En fait, il s’agit d’un héritage en pleine propriété (appelé morgengab) aux premiers siècles qui est ensuite transformé en droit d’usufruit dans le but de maintenir les biens dans les familles puisqu’ils vont ensuite aux enfants qui sont les nus-propriétaires. Le douaire est légalisé par une ordonnance de Philippe-Auguste en 1214.
…Au sud
Dans les pays de droit écrit, dont les coutumes sont très largement influencées par le droit romain, la « quarte du conjoint pauvre », venue du droit romain, permet au conjoint de recevoir un quart de la succession du prédécédé, en usufruit s’il y a des enfants ou en propriété dans le cas contraire.
Quel que soit le contexte, on retrouve le même souci d’assurer au conjoint survivant un minimum de ressources pour vivre ou pour conserver son train de vie antérieur, qui a fait naître des institutions appelées « gains de survie ».
Mais le douaire est remis en cause à partir du XIVe siècle, époque à laquelle la renaissance de certaines idées venues du droit romain, aussi bien dans le Midi que plus au nord, accroît les pouvoirs du mari au détriment de la femme. L’importance de la communauté de vie, forte notamment aux XIIe et XIIIe siècle, régresse dans la plupart des régions, au profit des liens du sang. Dans certaines, la femme doit renoncer à son douaire car il rend le patrimoine indisponible.
Néanmoins, il existe de multiples exemples d’épouses héritières par la volonté de leur époux. Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, sénéchal de Champagne, donne à son épouse, vers 1470, l’usufruit de tous ses acquêts en châteaux, villes, seigneuries et revenus, la propriété de ses biens étant distribuée entre les enfants. En 1474, René, roi de Sicile, duc de Bar et de Lorraine, donne à son épouse différents domaines, duchés et comtés, alors même que son héritier universel est son neveu, Charles d’Anjou.
De la famille élargie à la cellule familiale

Le mariage au XVIIIe siècle
De manière générale, dans l’ancien droit en France, comme en droit romain, le conjoint survivant succède seulement à défaut de tout héritier par le sang. En effet, si, en faveur des droits successoraux du conjoint, on trouve l’argument des « affections présumées du défunt », à l’inverse s’impose le souci de conserver les biens dans les familles car en l’absence d’enfants, si l’épouse hérite, les biens passent dans sa famille.
Qu’en est-il à la Révolution ?
Dans le droit intermédiaire (celui de la Révolution française) et le Code civil de 1804 subsiste l’idée du devoir de famille. Il ne concerne plus les lignées mais les parents proches, la famille-souche.
Le conjoint survivant, qui ne fait pas partie de la famille définie par les liens du sang, ne succède donc qu’à défaut de tout parent, soit des enfants, soit des collatéraux jusqu’au douzième degré : autant dire qu’il ne succède que dans de rares cas.
Cependant, la loi du 17 nivôse an II (6 janvier 1794) prévoit une quotité disponible (partie des biens qu’une personne peut léguer par testament à qui elle veut car cette part n’est pas réservée à ses héritiers légaux) spéciale en usufruit pour le conjoint. Ces libéralités (dons et legs) autorisées permettent d’assurer la subsistance du conjoint dans la mesure où les « gains de survie » ont été supprimés.
Ce qui change au XXe
Mais l’évolution légale, par la suite, favorise peu à peu le conjoint.
La loi du 9 mars1891 permet au conjoint de se voir attribuer l’usufruit sur une partie de la succession, faute de quoi il a droit à une pension alimentaire sur la succession.
La loi du 31 décembre 1917 (sans doute motivée par le grand nombre de morts, donc de veuves dont on veut améliorer la situation) limite les droits des collatéraux à ceux situés au sixième degré de parenté. Celle du 3 décembre 1930 élargit encore les droits du conjoint. La loi du 26 mars 1957 va plus loin en éliminant de la succession tous les collatéraux ordinaires (autres que les frères et sœurs) au profit du conjoint survivant.
Aujourd’hui, c’est la définition-même de la famille qui a changé et donc entraîné une amélioration de la situation du conjoint survivant : la famille resserrée autour du couple et des enfants a remplacé la famille-souche. C’est le ménage, la communauté de vie qui compte et le conjoint est au centre de cette famille-là. Depuis la loi du 3 décembre 2001, il a le choix (à moins qu’existent des enfants d’un premier lit) entre recevoir le quart de la succession de son conjoint prédécédé ou l’usufruit de la totalité.
Dans une seconde partie, nous étudierons l’héritage des femmes en tant que « filles » et non « épouses ».
À propos de l’autrice
Paule Valois est guide-conférencière professionnelle, historienne, journaliste. Elle propose des visites thématiques, fait découvrir le Paris historique, visible dans l’art de ses monuments et le destin de ses grandes figures, mais aussi l’histoire des Parisiens, et des femmes en particulier, à travers les événements historiques mais aussi la législation et les habitudes de la vie quotidienne.