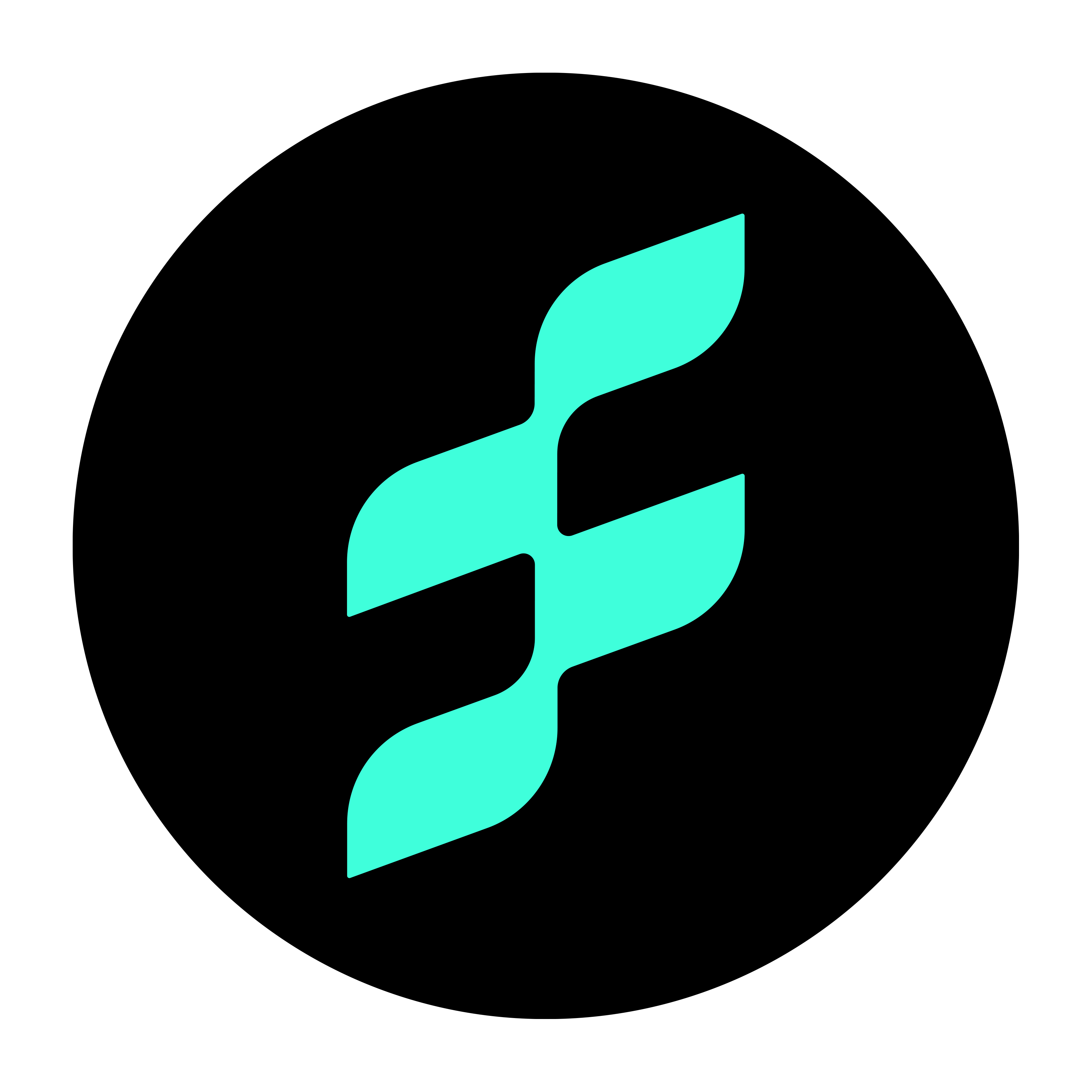Deux expositions mettent à l’honneur les femmes artistes de deux époques très différentes – le début du 19e siècle et une grande partie du 20e siècle. Moyen d’émancipation pour les premières, l’art s’impose comme un espace privilégié des luttes féministes et civiques pour les secondes.
Par Gilles Marchand
« Peintres femmes, 1780-1830 : Naissance d’un combat » : dès son titre, l’exposition organisée par le Musée du Luxembourg (à voir jusqu’au 25 juillet) donne le ton. Si Elisabeth Vigée Le Brun, considérée comme la plus grand portraitiste de son époque, a ouvert la voie, le combat des peintres femmes s’est réellement structuré par la suite, pendant la période d’une cinquantaine d’années que couvre l’exposition.
C’est d’ailleurs le grand mérite de cette mise en lumière par le musée : faire le lien entre les œuvres de ces pionnières et leur rôle dans les changements sociaux de l’époque – notamment le droit à la formation et la professionnalisation des femmes artistes.
De l’éducation des jeunes filles à leur émancipation
L’exposition montre notamment comment, à l’image de leurs homologues masculins, elles ont progressivement constitué de véritables réseaux d’entraide dans les ateliers. Une approche indispensable pour passer du simple loisir à une carrière, et ainsi obtenir des commandes et vendre leurs peintures.
En effet, cette époque, on note d’abord un engouement pour la pratique artistique, considérée comme un élément important de l’éducation des jeunes filles de bonne famille.
Pour certaines d’entre elles, la maîtrise du pinceau deviendra le moyen de s’émanciper, à marche plus ou moins forcée. C’est par exemple le cas de Marie-Guillemine Benoist, née dans le milieu de la grande bourgeoisie ; lorsque son mari connaît la disgrâce à cause de ses positions contre-révolutionnaires, la peinture deviendra une source de revenus précieuse…
Petit à petit, les ateliers vont accueillir des femmes de classe modeste, pour lesquelles la peinture devient une garantie contre le risque de précarité, en cas de veuvage notamment.
L’abstraction pour langage universaliste
 Avec « Elles font l’abstraction », qui se tient jusqu’au 23 août, le Centre Pompidou prolonge cette histoire : après le temps de l’émancipation balbutiante, vient celui des combats politiques et de l’utilisation de l’art pour changer le monde en dénonçant ses dérives.
Avec « Elles font l’abstraction », qui se tient jusqu’au 23 août, le Centre Pompidou prolonge cette histoire : après le temps de l’émancipation balbutiante, vient celui des combats politiques et de l’utilisation de l’art pour changer le monde en dénonçant ses dérives.
Particulièrement riche avec ses centaines d’œuvres, relevant aussi bien des arts plastiques que de la danse, la photographie, les films ou les arts décoratifs, l’exposition propose un voyage au pays de l’abstraction, de ses origines aux années 1980, en mettant à l’honneur près de 110 artistes femmes.
Comme Christine Macel, commissaire générale de l’exposition, l’explique dans un entretien accordé au Monde, celles-ci ont souvent été mises à l’écart de l’histoire officielle de l’art pour différentes raisons :
« L’accès à l’éducation artistique, et surtout la condition de la femme en général jusqu’aux années 1960, qui a limité – voire bloqué – leur reconnaissance. Beaucoup d’artistes femmes entrées en abstraction ont cru qu’un tel langage qui portait des valeurs universalistes allait leur permettre d’échapper à cette problématique, mais ce ne fut pas le cas, jusqu’à la période féministe des années 1970. »
Mettre en lumière les abus dont les femmes sont victimes
Verena Loewensberg est emblématique de ce plafond de verre : dans les années 1940, la peintre et graphiste suisse est l’unique femme du cercle des artistes concrets zurichois, qui rassemble Max Bill, Richard Paul Lohse et Camille Graeser. Pourtant, contrairement à ces derniers, elle ne recevra jamais le Prix des arts de Zurich.
L’abstraction devient également un moyen de réparation des abus dont sont victimes les femmes, à l’image de Lynda Benglis, qui répand à la fin des années 1960 des bandes de latex liquide coloré sur le sol. Ces « fallen paintings » évoquent les « fallen women », ou « femmes déchues », terme utilisé en Grande-Bretagne pendant l’ère victorienne pour décrire des femmes ayant « perdu leur innocence », et mises au ban de la société.
Un combat pour s’inscrire dans la communauté féminine, ancestrale et sans frontières
Harmony Hammond, l’un des fers de lance artistiques des luttes féministes des années 1970-80, est reconnue pour ses pièces tissées et peintes, qui s’inspirent de méthodes traditionnelles du Mexique. Son ambition est d’inscrire sa démarche dans une lignée d’artistes et artisanes, pour se reconnecter à une culture féminine ancestrale souvent ramenée au statut d’« arts inférieurs ».
Citons aussi, parmi beaucoup d’autres artistes engagées, Howardena Pindell, qui a participé aux luttes pour les droits civiques et aux revendications féministes.
Le motif du cercle, très présent dans son œuvre, renvoie à un souvenir d’enfance : les cercles rouges marquaient les verres destinés aux personnes noires dans les bars ségrégationnistes du Kentucky.
En 1979, elle publiera anonymement l’article « Action against Racism in the Arts », pour dénoncer le racisme de la scène artistique new-yorkaise.
Pour aller plus loin sur « Elles font l’abstraction » :
- La série de podcasts réalisée par le Centre Pompidou
- La présentation détaillée des artistes de l’exposition par Art Newspaper
Crédit photos : © Violaine Cherrier (Sonia Delaunay – Centre Pompidou) / Elles font l’abastraction, Centre Pompidou